Dimanche 22 mars 2020. Sixième jour de confinement
3è défi. Privation d’un petit plaisir quotidien
Troisième défi d’écriture proposé à distance par Carole Lacheray, qui anime l’atelier d’écriture à Trouville-sur-mer. Découvrez son blog (http://osezecrire.blog.free.fr) ou la page Facebook (https://fb.me/osezecrire), puis n’hésitez pas à vous lancer vous aussi, et à partager.
« Ainsi nous ne voyons jamais le véritable état de notre position avant qu’il n’ait été rendu évident par des fortunes contraires, et nous n’apprécions nos jouissances qu’après que nous les avons perdues. » Daniel Defoe, Robinson Crusoé.
Vous voilà vous aussi, comme Robinson, coupé(e) du monde. Je vous propose de faire l’inventaire des petits plaisirs quotidiens dont vous ne prenez peut-être conscience que maintenant que vous en êtes privé(e).
Bien entendu, le narrateur de votre texte n’est pas forcément vous…. et l’humour est fortement conseillé, mais ne le révélez qu’à la fin pour nous laisser le plaisir de deviner.
La porte verte
Chaque matin, depuis maintenant huit ans, j’ouvre la porte verte et sors prendre mon petit déjeuner dans un des cafés du quartier. C’est une habitude à laquelle je ne déroge jamais. Été, hiver, qu’il vente ou qu’il pleuve. De toute façon, au Portugal, le ciel est abonné au bleu, surtout dans la région de Lisbonne, et plus encore au sud, dans l’Algarve ou l’Alentejo. Mais moi, je vis à Lisbonne et le climat me convient parfaitement, ainsi que mes petites habitudes. J’ai toujours été matinal, même du temps où je travaillais à la papeterie, avant de prendre ma retraite. J’aimais me rendre à la fabrique à pied, à moins d’un kilomètre, pour attraper les premières lueurs du jour, profiter des trottoirs déserts, comme si j’avais la ville pour moi seul. Et depuis huit ans, réveillé à 6 heures, rasé, débarbouillé, habillé, je sors à 7 heures tapantes de mon appart de Campo de Ourique. 75 mètres carrés de vieux parquet grinçant, c’est grand, pour un homme seul. Un long couloir sombre, un balcon trop étroit pour y installer une chaise, et qui plonge sur un fond de cour. Rien qui donne vraiment envie d’y rester. Alors que dehors, une fois franchie la porte verte, la lumière est extraordinaire, en toutes saisons. Une qualité de lumière unique, un scintillement hors du temps, une réflexion de celle-ci sur les pavés blancs, un éblouissement absolu. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle Lisbonne La ville blanche. D’autres que moi s’y sont usés la rétine, en terrasse des cafés sur les places pavées de noir et de blanc. La lumière de la ville, contrastant avec la cage d’escalier sombre, m’assaille, me blesse, et pourtant, me rend chaque jour plus vivant.
Dès 7 heures, du lundi au dimanche, je marche dans mes rues habituelles. Je salue silencieusement chaque façade colorée, chaque boutique de quartier, chaque porte d’immeuble, qui font partie de mon univers, de mon histoire et de ma vie. Portugais depuis toujours, des générations d’ancêtres avant moi ont aimé et célébré cette ville, chacun à sa manière. La mienne, c’est de marcher sans fin dans le dédale des rues, pour finir par m’asseoir dans un café. Je choisis en général une terrasse ombragée, déplie le Correia da Manha et commande mon premier expresso. Un bica, serré, amer et voluptueux, mélange improbable mais réel, pour bien démarrer la journée. J’ai mes cafés préférés bien sûr, comme nous tous, trois ou quatre lieux fétiches. J’avale une première gorgée, oublie le journal et m’abandonne au spectacle de la rue lisboète. Ses passants, ses arbres, ses pigeons, bercent mon imaginaire et mes souvenirs. Dans une autre vie, j’aurais été poète et aurais rempli de textes les pages quadrillées de ces carnets de moleskine que notre papeterie fabriquait, à l’époque. La conclusion de mon bonheur tombe, tendre couperet, chaque jour identique : l’expresso portugais est, à n’en pas douter, le meilleur au monde.
Chaque matin est une répétition du même jour. Elle est belle, la vie de retraité. Chaque matin, je ferme la porte massive de l’appartement, descends quatre volées de marches grinçantes, tel un gamin filant à un rendez-vous amoureux. Chaque matin, je franchis le hall carrelé, bordé d’azulejos jaunes et bleus, attrape la poignée de cuivre et pousse la porte verte. Impossible de l’ouvrir. Je pousse un peu plus fort. Elle résiste. Quelque chose dans le mécanisme s’est grippé ? Elle est si vieille cette porte verte, immuable et archaïque comme cet immeuble, et bien plus vieille que moi, qui traîne pourtant sept décennies accrochées à la carcasse. Je devine la lumière de la rue Correia Teles à travers sa vitre translucide. Est-ce vraiment la première fois que la porte d’entrée se coince ? Un doute s’insinue en moi, l’impression d’un déjà-vu, d’un déjà vécu. Je soupire, ferme les yeux pour chasser cette sensation fugace.
Marie-Jeanne pose sa main sur ma main tavelée. J’ouvre les yeux. Avec son accent normand, l’aide-soignante me rappelle à l’ordre. « Monsieur Santos, il ne faut pas sortir, les promenades ne sont plus possibles pendant le confinement ». Je la regarde sans comprendre. « Les visites à l’Ehpad sont interdites, souvenez-vous ». Elle détache chaque mot d’un ton bienveillant, et ma main de la porte blanche de l’établissement. « Votre fille Ana va vous parler par skype, de Rouen ». Elle me conduit tout doucement vers la salle commune, sans cesser de me parler. « Vous savez bien, Ana, votre fille, elle travaille à cent kilomètres d’ici. Elle vous appellera à dix heures, je vous allumerai votre tablette. Mais venez d’abord prendre votre petit-déjeuner avec les autres résidents, monsieur Santos ».
Isabelle Lebastard
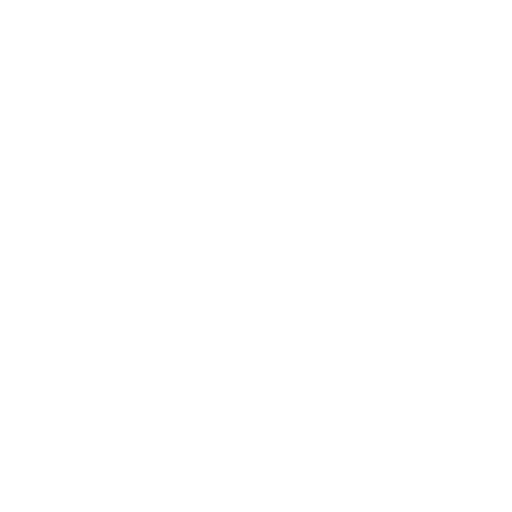 Prev
Prev