Mercredi 22 avril 2020. Trente-septième jour de confinement
11ème défi. Nouvelle à chute avec phrase d’Édouard Philippe
Onzième défi d’écriture proposé à distance par Carole Lacheray, qui anime l’atelier d’écriture à Trouville-sur-mer. Découvrez son blog (http://osezecrire.blog.free.fr) ou la page Facebook (https://fb.me/osezecrire), puis n’hésitez pas à vous lancer vous aussi, et à partager.
Ça y est, on pense à l’après, on l’envisage, on se projette…
Pour ce onzième défi, je vous propose d’écrire une micro nouvelle (moins de 6000 signes) dont la chute sera inattendue et dans laquelle vous insérerez cette phrase, extraite du discours d’Édouard Philippe :
« À partir du 11 mai, ce ne sera pas la même vie qu’avant le confinement. Nous allons apprendre à organiser notre vie. En vivant dans un quotidien qui sera un peu différent. »
Le Maître et l’Apprenti
Ils sont venus au petit matin, en plein cœur de l’hiver, alors que nous dormions encore. Ils sont entrés dans nos foyers, nous ont arrachés aux limbes du sommeil et à la douceur de l’innocence. Ils nous ont séparés, sans un mot, et jetés dans des véhicules bâchés, derrière d’immondes barreaux. J’entendais mes sœurs, Léa et Myriam, dans l’autre camion, hurler et appeler au secours. Mon petit frère Benjamin s’accrochait à moi, tétanisé. Mes parents avaient disparu. Je ne le savais pas encore, mais je ne les reverrai jamais. Les camions roulèrent sans fin. Nous ne savions pas où nous allions, la bâche masquait la route et le paysage. À côté de nous, d’autres jeunes, derrière d’autres barreaux, tremblaient d’effroi. Je ne les connaissais pas. La rafle matinale avait eu lieu dans plus de foyers que le nôtre. Les kilomètres défilaient, le jour s’était levé depuis longtemps et le soleil tapait fort sur la bâche. Nous avions soif, tellement soif. Nos ravisseurs ne nous avaient pas donné d’eau, et ne comptaient visiblement pas nous en donner. Nous suffoquions, l’air manquait. Certains d’entre nous s’évanouirent, de fatigue, de peur, d’asphyxie, déshydratés. Un petit mourut, il s’affala parmi les corps de ses camarades, tassés comme des bestiaux dans un parc. C’était inhumain, on nous traitait comme des cochons en route pour l’abattoir. Je sentais la rage m’envahir et dus lutter pour ne pas insulter ces monstres : je devais garder mon souffle, économiser de l’énergie. Moi, Gabriel, je devais protéger mon petit frère.
Le camion freina brusquement. On nous déchargea brutalement. Le chef des ravisseurs, en bottes noires et hautes, cria ses ordres, repoussant sans ménagement nos camarades morts. Il nous déposa en plein soleil, toujours prisonniers, toujours assoiffés. Un homme arriva, en bottes lui aussi. Une discussion s’engagea entre les deux hommes mais je ne comprenais pas leur langue. Un transfert eu lieu, un sombre arrangement se négocia. Nous étions jaugés, soupesés, tels du bois d’ébène pour des plantations de canne à sucre. La chaleur nous étourdissait, nous ne réagissions plus. Une seule arrière-pensée nous soutenait encore : boire, par pitié, boire. L’homme choisit alors cinq de mes camarades et moi-même. Benjamin, plus jeune, plus fragile, ne fut pas désigné et nous fûmes, malgré nos hurlements, séparés. L’homme nous balança dans un nouveau camion, nous reprîmes la route, toujours sans boire ni manger, ahuris, épuisés. J’avais perdu toute ma famille.
Enfin nous arrivâmes, dans ce qui ressemblait plus à un camp de réfugiés qu’à un centre de vacances. On nous poussa vers de pauvres baraquements de tôle ondulée, au sol de terre battue. Terrorisés, nous nous serrions les uns contre les autres. On nous donna enfin à boire : une eau tiède et croupie, sur laquelle nous nous jetâmes. La nourriture était infecte. Nous ne savions pas où nous nous trouvions. Un haut et solide grillage entourait une sorte de parc, un méchant terrain vague. Une porte cadenassée fermait l’entrée. Nous étions confinés. De temps en temps, des chiens bruyants passaient. Agressifs, ils aboyaient pour un oui ou pour un non, nous dissuadant de nous échapper. Quand le Maître nous rendait visite, de son pas rapide, campé sur ses grandes bottes noires, les chiens se déchaînaient de plus belle.
Les jours, les semaines, les mois passèrent. Je ne comptais plus les jours. Je ne savais plus quand nous étions. L’hiver semblait fini, et le printemps s’avançait. À vue de nez, nous devions être en mars. Ce confinement forcé nous arrachait au temps. De nouvelles recrues arrivaient, régulièrement, perdues comme nous l’étions au premier jour. La population dans le camp gonflait dangereusement. Nos conditions de vie, ou plutôt de survie, insalubres, s’aggravaient de jour en jour. Nous manquions de place pour dormir. Le soir, je me tassais dans un angle de mon baraquement et pourtant, au matin, je me réveillais sous une mêlée confuse de corps et d’odeurs. Nous n’avions plus aucune hygiène. Les excréments traînaient partout. Il était impossible de ne pas marcher dedans, de ne pas coucher dessus, les rares banquettes étant prises d’assaut par les petits chefs. Beaucoup toussaient, certains mouraient. Le pire, c’est que leurs corps n’étaient pas dégagés le jour même, et nous devions supporter les visions d’horreur doublées des miasmes de la décomposition. C’est pendant cette période que je perdis mes deux nouveaux amis, Albert et Simon.
L’atmosphère du camp était sous tension. La chaleur de la tôle ondulée, qui brûlait les baraquements et nous grillait nous le soleil, ajoutait de l’électricité à l’air. Certains de nous se battaient, se blessaient, balançant leur agressivité vers leurs frères de misère, ne pouvant la retourner contre nos bourreaux. La quantité de nourriture ne suivait pas. Nous aurions vendu notre âme pour quelques miettes, et moi, Gabriel, éduqué dans la moralité la plus saine, je dois l’avouer : j’ai arraché un croûton de pain de la bouche d’un de mes camarades. Toute dignité était dès lors perdue.
Le temps du confinement continua à passer sans passer. Les pommiers et les lilas, dans la belle nature autour du camp, étaient en fleurs. J’en déduisis que nous devions être en avril. L’Apprenti du Maître avait maintenant pris l’habitude de venir nous voir tous les jours. Un jeune, qui avait l’air bien moins méchant que son mentor. Il nous distribuait toujours une petite dose de nourriture en plus et en douce, je l’avais remarqué. Un matin, il s’est planté devant le grillage. J’étais de l’autre côté, exactement en face de lui. Quelques centimètres, à peine, et la liberté nous séparaient. Nous nous sommes longuement regardés dans les yeux, fixement. Puis, il a parlé. Avec un drôle d’accent, certes, mais je suis arrivé à le comprendre. Nous ne parlions pas la langue de nos ravisseurs, mais lui, le jeune, l’Apprenti, avait fait l’effort d’assimiler la nôtre. Il me dit, très lentement et très distinctement, comme pour moi seul : « J’ai pitié de vous ». Il tourna le dos et partit.
Je n’arrivais plus à dormir. L’épuisement se mêlait à l’excitation. L’espoir était revenu. Pourtant, après avoir désespéré si longtemps, l’espoir peut s’avérer néfaste voire dangereux, je le savais. Mais je ne pouvais m’empêcher de tirer des plans sur la comète, de rêver d’évasion, de nouvelle vie. L’Apprenti nous aiderait, j’en étais sûr désormais. Je devais le revoir, en tête-à-tête, arriver à le convaincre, à jouer davantage sur sa pitié, son humanité, son sens des responsabilités.
Un matin, début mai sans doute, l’inconcevable se produisit. Une fumée noire s’échappa de la cheminée du très haut bâtiment qui faisait face au campement. Le vent la poussa vers nous. Mes camarades et moi sentîmes, horrifiés, l’odeur de la chair brûlée. Une odeur reconnaissable entre toutes. Non, je ne voulais pas croire ce que je sentais. Non, ce n’était pas possible. Non, ils ne pouvaient pas faire cela. Et pourtant, beaucoup d’entre nous avaient mystérieusement disparu du camp ces derniers jours, pendant la nuit. Je me réveillais au matin et les corps endormis sur le mien, les corps à pousser pour sortir du baraquement, étaient nettement moins nombreux.
L’Apprenti est revenu. Il s’est planté devant moi, encore une fois, derrière le grillage. On dirait qu’il m’a choisi, moi, comme meneur du groupe, ou comme confident. Peut-être qu’on se ressemble, qu’il sait qu’il aurait pu être à ma place, ici. Il a parlé dans notre langue, lentement, mais je l’ai compris. « Demain, c’est le 11 mai. Demain, c’est mon anniversaire. Je vais faire quelque chose pour vous, pour moi, et ce sera mon cadeau ». Il est parti avant que j’aie pu ajouter un mot.
Lundi 11 mai, au petit matin. L’Apprenti a tenu parole. Il s’est faufilé au lever du jour, et tenait la clé du baraquement qu’il avait dérobé au Maître. Il a ouvert la porte. « Partons, nous a-t-il dit, enfuyons-nous à travers ce champ, vers cette forêt, retrouvons notre liberté ! ». Je m’élançai comme je pus, les larmes aux yeux, en compagnie de mes frères. Notre petite troupe, faible et pathétique, cavalait sur des jambes fragiles vers la forêt refuge. Arrivés dans la clairière, nous étions à bout de souffle, peu habitués à l’exercice physique. L’Apprenti se mit alors, tout naturellement, au centre du cercle que nous formions, tel un nouveau guide, sauveur de notre peuple, gardien de notre infortune. Il prit la parole. « Mes amis, nous voici libres. Cette date restera dans vos mémoires. À partir du 11 mai, ce ne sera pas la même vie qu’avant le confinement. Nous allons apprendre à organiser notre vie. En vivant dans un quotidien qui sera un peu différent. »
Mardi 12 mai
Le morveux est revenu à la maison, la queue entre les jambes, après une nuit dans la nature qu’on l’croyait perdu. Ah, j’te lui ai passé un de ces savons, y s’en souviendra. Qu’est-ce qui lui a pris, au gosse, d’ouvrir le poulailler, de libérer toute la volaille, d’un coup, comme ça ? Il est dingue ce petit, avec sa sensiblerie, il doit tenir ça de sa mère. Mais je lui ai filé une bonne punition : aujourd’hui, et jusqu’à ce soir, y va m’ébouillanter, me plumer, me vider et me préparer tous les poulets qu’on a réussi à rattraper et que j’ai égorgés ce matin. Comme ça, il pourra plus dire qu’il sait pas d’où ça sort, quand il mange ses nuggets au Mac Do, l’hypocrite.
Isabelle Lebastard
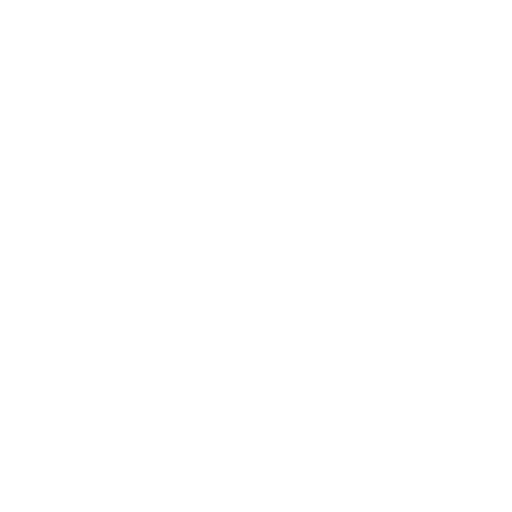 Prev
Prev