Alors oui on peut tenter le coup de l’écriture au kilomètre. Mais dans quelle direction partir ? Aucune idée. Et ce thème-là, sous quel angle l’aborder ? Aucune idée non plus. Donc, autant lâcher prise, laisser s’agiter mes doigts sur le clavier du portable dans ce café bondé, sans même relire ce que j’écris, sans revenir en arrière pour corriger mes fautes de frappe, mais que voulez-vous, avec cette presbytie qui galope, travailler sur écran 9 pouces avec un doc LibreOffice zoom 80% pour que mes voisins, à la vue sûrement plus affûtée que la mienne, ne puissent zieuter par-dessus mon épaule et se foutre de mes divagations matinales au café noir, ça aide à foncer dans le texte sans revenir au début d’un paragraphe dont la majuscule initiale s’éloigne aussi sûrement que le point de fuite d’une perspective paysagère.
Pourquoi je me gênerais ? Dites-le moi, pourquoi je devrais me gêner. Ce que j’écris là, c’est peut-être n’importe quoi, j’en conviens, mais d’abord, je ne me suis pas relue. Forcément, puisque je suis en train de l’écrire, ici même, sous vos yeux, ou peu s’en faut. Concentrée sur ces phrases qui s’inscrivent à l’écran au fur et à mesure qu’elles sortent, comme les tortillons bleus et blancs d’un tube de dentifrice pressé le matin. Pour tout vous avouer, si on choisit la sincérité, vous et moi, je n’ai aucune idée des mots qui ont précédé, des mots qui courent et se prélassent ci-dessus, à peine quelques lignes plus haut. J’en oublie au passage de respirer, emportée par le souffle de la phrase. Je n’ose vous faire le coup de l’inspiration, bien que ça me démange, mais l’idée y est, bref, je ne respire pas, je travaille en apnée, dans les profondeurs sombres et nobles de ma tasse de café bien serré, pour un peu j’en oublierais de mettre des points, je pense à peine aux virgules, les points c’est difficile, ça demande plus de concentration, peut-être parce qu’avec un clavier Azerty, il faut appuyer sur la touche Maj en même temps et qu’en situation de pénurie d’oxygène, ça nécessite trop d’efforts. Ah ça y est, j’en ai mis un, appréciez. Inspiration. Voyez comme le métier de l’écrivain est dangereux. Expiration. Imaginez les titres en affichettes sur les baies vitrées de ce bar : « Littérature. Hécatombe au sein de la profession. Encore un écrivain retrouvé noyé dans son café » ou bien : « LLL (L’écrivaine Locale Lexovienne) découverte asphyxiée à la table de son bistrot favori ». Poumons vides. Alvéoles noires. Page blanche. À moitié remplie.
Donc, où en étais-je ? Ah oui, je reprends le fil de ma démonstration, peut-être pas très rigoureuse, ni forcément bien structurée, j’en conviens, surtout à cette heure matinale où chacun cherche en lui raisons et motivations pour affronter une journée de boulot, et où d’autres, dans mon cas, cherchent des mots assez forts pour affronter la masse de pages blanches générées par la touche Entrée de leur clavier. Besoin d’un café. J’ai beau écrire, la création virtuelle s’allonge sur l’horizon des retours à la ligne et le bout du texte s’éloigne sans cesse. Comment dans ce cas atteindre l’extrémité du document, l’heureux ou malheureux mot Fin caché si loin, bien en-dessous de la barre des tâches ? Une fin qui tente de cerner, de limiter dans ses débordements invasifs les monticules de lignes qui s’accumulent, se superposent, se recoupent, comme des vagues issues d’ondes cérébrales entrecroisées, minis raz-de-marée des émotions α ou β courant à travers les lettres compressées, les mots bousculés et les phrases secouées, et les dix doigts au clavier, ou six peut-être aller j’exagère, voire quatre dans mon cas désespéré, qui tentent de peigner, compulsivement, et j’ai perdu la structure de ma phrase au passage, la chevelure de cette sirène hirsute à peine sortie des flots de l’inconscient. C’est beau, hein ? Vous vous y voyiez déjà, pas vrai ? En train de reluquer les fesses pailletées de la sirène sur son rocher, voire, de lui faire du bouche à bouche pour la réanimer. Mais attendez, une sirène, moi, c’est pas ses seins d’étoile de mer ou son cul nacré d’écailles qui m’intéresse, c’est sa voix : une sirène chante, enivre, étourdit son public, passé ou actuel. Oui, elle sert à ça, la sirène, dans les histoires : à faire oublier tout le reste. Sauf cette voix. Qui nous entraînera loin, vers des territoires d’où l’on ne reviendra pas indemne, vers des zones d’ombre au fond desquelles on se noiera. Pas forcément celui d’une tasse de café, la solidarité absolue avec l’auteur n’est pas exigée, faut pas abuser. Et puis, après avoir oublié et être parti, on veut revenir et se souvenir, mais sous l’effet de ce chant, on néglige l’histoire qui se déroule devant nos yeux et on continue à lire. C’est le but recherché, continuer à lire, au point où on en est rendus, vous et moi, autant jouer la transparence totale. On est pris dans les mêmes eaux, compagnons de voyage, de délire et d’infortune, on peut se soutenir mutuellement, votre bras autour de ma taille et vice-versa, on rame un petit coup, on pagaie de notre main libre. En direction d’un rivage inaccessible : le comptoir de zinc, froid et brillant, le bas d’une page virtuelle étendue vers l’horizon bleu ciel, ce bleu de Windows Cévennes et des légendes d’autrefois où la terre était plate. On évite la grande cascade finale, chute verticale dans le néant étoilé. De nos jours, on connaît tous la sphère Google. L’information se mord la queue, vaste serpent de la connaissance. On se rattrape in extremis aux cheveux de la sirène, le tour de chant était pas mal mais on va pas y laisser notre peau. On revient s’asseoir ici, le café a légèrement refroidi, c’est pas grave, on est habitués à le boire froid et on le boira ensemble.
Donc, où en étais-je, vous disais-je. Ah oui, c’était cela : Pourquoi je me gênerais ? Hein, dites-le moi enfin, pourquoi je devrais me gêner. C’est vrai, vous questionnez-vous encore à ce stade, car je n’ai guère éclairé votre lanterne, malgré ce voyage en eaux sombres et ce noir café partagé. Et bien, vous répondrais-je illico presto dans ce paragraphe, avant que vous ne me quittiez, me gêner pour écrire ce dont j’ai envie et qui me vient à l’esprit, parce que ça sera sûrement mauvais, mais pas plus que ces bouses au kilomètre qu’on nous sert dans les meilleures librairies sous bandeau rouge, nom écrit très gros en lettres blanches ou noires, ça dépend de l’effet recherché, pages au grain fin, papier blanc pur ou légèrement jauni et tramé, mon préféré, 120 grammes, calligraphie unique reconnaissable entre toutes, reliure brochée, collection prestigieuse, éditeur encore plus prestigieux. L’auteur, s’il est suffisamment cynique pour être revenu de tout, y compris de ce voyage en eaux mortes, vendrait son âme si elle avait survécu et son cul si quelqu’un en voulait, pour avoir le privilège de figurer dans LA collection et voir son nom s’ajouter au bas de la liste, finie et limitée de ceux qui l’ont précédé, vingt-deux euros cinquante s’il vous plaît, vous réglerez en espèces ou par carte bancaire ?
Mine de rien, nous voici parvenus, vous et moi, face à face, sur ce même radeau, par les flots de nulle part, à l’extrémité du territoire des pages blanches. Plus rien en dessous. Avec ma petite gueule passéiste et ces mots passe-partout, j’ai réussi, ne le niez pas, je sais que vous êtes encore là, à vous garder à mes côtés et à vous faire lire 7798 caractères Times New Roman Police 14, espaces non compris, alors que généralement, ne mentez pas, ça aussi je le sais, quand vous mentez, et j’ai des preuves, vous ne dépassez pas la cinquième ligne du premier paragraphe des manuscrits que les auteurs vous envoient, bouteilles à la mer, boomerangs normands jetés derrière le comptoir de leurs bistrots favoris.
Vous prendrez un sucre dans votre café ?
© Isabelle Lebastard
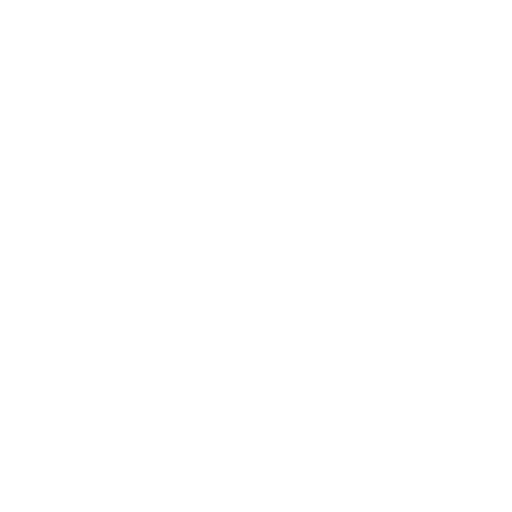 Prev
Prev