Si l’automne avait officiellement commencé ce 23 septembre, rien, à l’exception d’une date imprimée sur un calendrier, ne l’aurait laissé deviner. Une douceur estivale envahissait l’atmosphère de Saint-Julien-le-Faucon. Dans ce petit bourg, on incendiait volontiers le défunt mois d’août et sa sécheresse catastrophique, pour mieux déplorer l’été indien qui suivait, car on avait retrouvé le chemin du bureau ou de l’école sans pouvoir profiter de la belle arrière-saison normande. Seuls, les heureux chômeurs et retraités, en terrasse de l’unique café du village, appréciaient et commentaient cette météo hors normes saisonnières.
Vingt-cinq degrés à neuf heures du matin, une folie douce en septembre. L’envie d’un café au soleil acheva justement de réveiller Anne-Sophie. Elle décida de porter, une dernière fois peut-être cette année, sa jupe courte, celle qui lui tombait trois centimètres au-dessus des genoux, avant de la ranger dans le dressing pour six mois. Elle gara son crossover sur la place du bourg, dont le monument au mort fleurissait les quinze chers disparus de la guerre de quatorze.
Une jupe courte, oui, car ses jambes, elle pouvait les montrer. Élégantes, racées, elles avaient résisté aux ravages du temps. On ne pouvait pas, hélas, en dire autant du reste. Son ventre, malmené par plusieurs grossesses, n’avait jamais retrouvé son moelleux d’antan. Ses fesses, dont les grands glutéaux fatiguaient, suivaient une pessimiste courbe descendante. Ses seins, vidés par des allaitements consciencieux, avaient transféré leurs rondeurs de bonne mère aux joues rebondies de ses enfants. Des push-up bien garnis et des bretelles serrées à en taillader les épaules donnaient le change, l’illusion d’une consistance et d’un galbe. La ménopause avait entamé son travail mesquin et incisait, telle un canif, l’épiderme de son visage. Néanmoins, si l’on ne tenait pas compte de ces impondérables, on pouvait considérer qu’Anne-Sophie était, comme on dit, une belle femme pour son âge.
La quinqua entra dans son café habituel, salua le patron Jean-Claude et les têtes connues. Bonjour Micheline. Bonjour André, ça va ? Coucou Gilbert. Sans oublier le plus fidèle client, un pilier de comptoir, Patrick, que l’on surnommait Patrick-au-béret car l’on ne l’avait jamais vu se montrer sans ce béret gris sale, contrastant avec sa figure poupine écarlate. Un couvre-chef vissé sur sa tête en toutes saisons, masquant cheveux gris, clairsemés ou absents, nul n’en savait plus sur le sujet.
Au comptoir, une silhouette inconnue tournait le dos à la porte, assise sur un tabouret de bar. Anne-Sophie aperçut le temps d’un regard vertical des cheveux blonds coupés très courts, presque rasés, une nuque bien dégagée, un blouson de cuir noir, de mauvaise qualité, peut-être du synthétique, un jeans troué, peut-être volontairement, avec cette mode, on ne pouvait pas savoir, et pour finir, des chaussures de sport bleues. Se sentant observé, l’inconnu se retourna et Anne-Sophie reçut la fraîcheur de son visage en pleine figure. Le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, se contenta de la fixer sans répondre aux salutations qu’Anne-Sophie venait d’envoyer de-ci de-là. Ses iris très pâles, hésitant entre le jaune et le vert, entouraient une pupille plus féline qu’humaine. Anne-Sophie eut du mal à détacher ses yeux de ceux du garçon, prit le Ouest-France pour se donner une contenance, commanda un allongé et sortit s’installer en terrasse, au soleil. Patrick-au-béret saisit son verre de blanc et fit de même.
Le mot terrasse était un bien grand mot pour désigner l’extension asphaltée du café. Quelques chaises de rotin plastifié et quelques tables bancales occupaient le trottoir élargi. Derrière ce mobilier, les jardinières municipales empêchaient les voitures de stationner. La départementale traversait le village avec ses poids lourds que l’étroitesse de la route obligeait à ralentir. Le café se nichait entre le monument aux morts, à gauche et la boulangerie-pâtisserie, à droite.
Le décor était posé. Anne-Sophie sortit ses lunettes de soleil de leur étui, épousseta les verres avec une lingette antistatique, enleva ses verres progressifs et les remplaça par les verres teintés, progressifs eux aussi, tout le confort était là, discrétion assurée, nettoya un petit coup les verres précédents avant de les ranger dans l’étui des lunettes de soleil. Puis, ce rituel achevé, elle saisit l’allongé que la serveuse venait de déposer sur la table et en dégusta très lentement – un autre rituel – , la première gorgée brûlante. Elle continua de boire, toujours aussi lentement, s’imprégnant de chaque goutte du breuvage et de chaque rayon du soleil, tout en découvrant les nouvelles du jour.
Elle sentit alors comme une pression sur les épaules, comme une vague de métal qui coulerait de sa chevelure à son cou, et sut instantanément qu’on l’observait. Elle releva les yeux. Le jeune homme était sorti du café pour fumer. Debout sur le seuil, une cigarette à la main et tourné dans sa direction. Les rayons matinaux jouaient dans ses yeux. Un cadrage très cinématographique accentuait sa nonchalance travaillée, à la James Dean. Voyant qu’elle le regardait, il inclina légèrement la tête en arrière afin de l’appuyer contre le chambranle de la porte et c’est de là, dans cette position confortable, qu’il planta ses yeux dans les siens. Tout simplement.
Conséquence de l’adrénaline, le cœur d’Anne-Sophie marqua l’arrêt avant de repartir de plus belle. Sa gorge déglutit deux ou trois fois. Ses yeux, affolés, ne savaient où se poser. Dieu soit béni, elle avait ses lunettes de soleil, qui masquaient l’agitation de ses globes oculaires. Ses mains tremblaient, cachées par les feuillets désordonnés du quotidien. Depuis combien de temps un homme ne l’avait pas regardée ainsi ? Parfois, quelques messieurs de la soixantaine lui lançaient des clins d’œil appuyés, sans gêne aucune malgré leur laide bedaine et leurs traits dégoulinants. De temps à autre, quelques cinquantenaires lui souriaient et lui faisaient comprendre à demi-mot qu’elle leur plaisait, mais bon, leur chair déjà fatiguée était à peu près aussi fade que la sienne. Exceptionnellement, un quarantenaire s’intéressait à elle l’espace d’un déshabillage visuel, avant de rhabiller prestement ledit regard, désolé madame, y’a erreur sur la marchandise. Mais depuis une – ou peut-être deux – décennie, aucun jeune homme ni homme jeune n’avait laissé ses yeux la pénétrer de façon aussi simple et directe. Anne-Sophie était devenue invisible à l’ensemble des hommes de moins de quarante ans. Comme presque toutes les femmes de son âge, elle en était bien consciente. Mais cette lucidité ne lui rendait pas la réalité moins cruelle pour autant.
Elle fit semblant de lire, en vain car les signes du journal s’agitaient, tels de noirs pépins malmenés par un shaker. Tête baissée, elle pouvait sentir le métal fondu se promener allégrement sur son front, son décolleté, ses bras et ses jambes. Elle jeta un coup d’œil à la dérobée. Immobile, bouche et blouson entrouverts, cigarette presque consumée à la main, le James Dean normand la brûlait d’un rayon laser jaillissant de ses iris jaunes. Le corps d’Anne-Sophie vibrait de la tête au cœur et du cœur au ventre. Les yeux clairs du jeune homme, en prise directe avec son abdomen, électrifiaient ses fibres utérines. De lentes palpitations, rouge vif, organiques et douloureuses, tétanisaient Anne-Sophie écartelée telle un rongeur en voie de dissection, dans l’attente du coup de scalpel fatal. Sa jeunesse, sa beauté, son insolence, autant de flèches lancées qui l’épinglaient sur le rotin de plastique.
Elle ne pouvait soutenir ce regard, chargé d’intensité animale. Ces yeux jaunes de chat, hypnotiques et sans fond. Des yeux qui n’avaient ni peur ni pudeur. Anne-Sophie ne pouvait même plus faire semblant de lire. Le gamin avait quoi ? Dix-huit, vingt ans ? À tout casser, vingt-deux. Il aurait pu être son fils. Facilement, même en l’ayant eu à trente. Elle eut alors envie de se lever, au ralenti, comme dans un film. De s’avancer vers lui en remontant sa jupe courte et de s’empaler, debout, sur son sexe dressé, contre le chambranle de la porte, le plus simplement du monde. Elle fixerait ses iris clairs et se laisserait envahir par la liqueur verte et blanche de son regard. Une lumière remonterait de son bas-ventre et envahirait son esprit dans un flash photographique. Ce moment serait fixé pour toujours dans l’album de sa vie tandis que ses yeux prendraient la teinte de ceux de son amant.
Insupportable. Il fallait partir.
Anne-Sophie rangea fébrilement ses affaires. Portefeuille, lunettes de soleil, portable, se retrouvèrent pêle-mêle au fond du sac à main pendant que ses doigts tremblants malmenaient la fermeture éclair du petit Longchamp. Elle devait maintenant simuler une trajectoire de sortie, apparemment naturelle, reliant la table de bistrot à sa voiture stationnée à gauche, sur la place. Elle pourrait ainsi passer entre le Patrick-au-béret assis à quelques mètres, et le jeune homme debout à l’entrée du bar, fumant toujours dans les rayons du soleil. Elle voulait dire un mot, à la recherche d’un prétexte pour connaître son nom, savoir s’il habitait dans le coin et s’il repasserait un jour, mais son cerveau, aussi paralysé que ses jambes, pédalait dans la semoule.
Elle prit une grande inspiration et se leva, raide et maladroite, reculant la chaise cannée qui gémit désagréablement. Le garçon ne broncha pas, aspiré dans les volutes de sa contemplation. Elle réussit à franchir la distance qui la séparait des deux individus et osa tourner la tête vers la créature.
– Au revoir jeune homme et bonne journée, parvint-elle à articuler.
Propos d’une banalité décevante, mais dans son état, impossible de se la jouer femme d’esprit.
C’est alors que Patrick-au-béret lui lança :
– Vous fatiguez pas, m’dame. Le p’tit, là, y cause pas. C’est un simple.
© Isabelle Lebastard
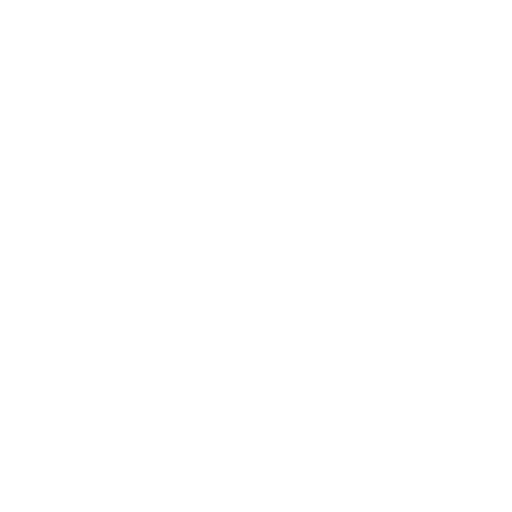 Prev
Prev