Céline sonna trois fois.
Le carillon égrenait ses pauvres notes dans la ruelle déserte. Le givre ornait de figures géométriques le portail métallique de la villa. Céline avait les mains et les pieds gelés. Bon sang, que fichait Katia ? Elle avait oublié leur rendez-vous ?
La porte s’ouvrit enfin. La tête de Katia émergea, ébouriffée, ses longs cheveux blonds tout en vrac. Réveillée depuis peu. Dans un de ses mauvais jours, visiblement.
– Ah Céline… salut … excuse-moi, je… j’avais pas entendu.
– Et bien alors, tu dormais encore ?
– Non non ! je suis levée depuis une bonne heure. Entre, tu as l’air frigorifiée.
Céline déposa sa veste matelassée sur le portemanteau, se déchaussa et enfila une des paires de pantoufles qui traînaient dans le hall. Une longue amitié entre les deux femmes permettait de couper court aux politesses convenues.
– Désolée encore, s’excusa de nouveau Katia, en robe de chambre. Je vais nous faire un thé tout de suite.
Céline suivit Katia dans la grande et lumineuse cuisine. La pièce préférée de son amie.
– J’ai cru que tu m’avais zappée. J’ai juste eu le temps de déposer les gamins à l’école et d’arriver.
– Bien sûr que non, comment pourrais-je t’oublier ! s’exclama Katia, outrée.
Quelques neurones se connectèrent dans l’esprit hébété de la grande blonde et aussitôt, son esprit vif et particulier, qu’appréciait tant Céline, retrouva ses marques.
Les deux amies avaient pris l’habitude de se rencontrer chaque mardi vers neuf heures, autour d’un thé. La plupart du temps chez Katia qui, peu matinale, laissait Gérard, son mari, conduire les gosses à l’école. Elle émergeait alors d’un néant glauque et entamait, ainsi qu’elle aimait à le décrire, une journée fatale de femme au foyer.
Le thé anglais Pur Breakfast, noir de chez noir, fumait dans les mugs. Katia transféra du frigo au micro-ondes une part du quatre-quarts de la veille, sans états d’âme, et sans se donner la peine d’enlever le film alimentaire qui le recouvrait.
La première gorgée avalée, Katia se lança.
– C’est complètement insensé.
– Quoi ?
– Ces gestes, là, tous ces gestes.
Les longs bras de Katia balayaient l’air de la cuisine comme pour illustrer et rendre évident un propos néanmoins obscur.
Céline ne s’étonna guère. Sa vieille amie était championne des sujets passant du coq à l’âne et des questionnements métaphysiques à neuf heures du matin, tout juste réveillée, ni peignée ni habillée.
– Tu parles de quels gestes ?
– Mais tous ces gestes, que je répète le matin. J’ai fait les mêmes hier, crois-moi si tu veux, exactement les mêmes. C’est dingue.
Céline poursuivit son questionnement, se demandant, avec une pointe d’amusement, ce que sa copine allait bien pouvoir lui sortir comme thème du jour pendant leur rituel du thé.
– Tu parles des gestes de la maison, des gestes domestiques en quelque sorte ?
– Oui, des gestes du matin. Enfin, c’est peut-être la même chose avec tous les autres gestes, mais j’ai vraiment tilté sur ceux-là.
– Tu as eu un flash sur tes gestes ?
– Oui. Avant-hier matin j’étais ici, dans ma cuisine, en train de vider le lave-vaisselle, et je me suis dit : tiens, je reconnais la scène. Et puis hier matin, ça recommence ! Je re-vide le lave-vaisselle, et j’ai le même flash: Déjà-vu. Et aujourd’hui encore…
Céline n’était pas surprise. Elle savait que son amie vivait très mal le fait d’avoir perdu son emploi et de se retrouver mère au foyer, elle qui n’avait pas vraiment la vocation de ménagère.
– C’est tout simplement parce que tu as vidé le lave-vaisselle trois jours d’affilée, et sans doute encore bien d’autres fois auparavant.
– Mais alors, pourquoi ça ne me l’avait jamais fait avant ?
– Et bien… Je ne sais pas moi, peut-être que là, tu étais dans un état spécial, très réceptive.
– Ces derniers jours j’étais complètement dans le cirage, tu veux dire. Je titubais dans ma robe de chambre, comme aujourd’hui, je clignais des yeux pour ne pas les refermer et m’endormir sur la chaise de cuisine, le nez sur la toile cirée. Je m’obligeais à faire quelque chose, en l’occurrence, commencer par ranger la vaisselle. Et c’est ce matin que j’ai eu mon flash le plus violent.
– Un flash désagréable ?
– Non, justement, pas du tout, pas de cet ordre-là.
Allons bon. Céline sourit. Katia était unique dans sa façon de voir et ressentir le quotidien.
– Une sorte de révélation pré-petit-déjeuner en quelque sorte, Dieu frappe sa brebis à n’importe quelle heure. Même la modeste ménagère n’est pas épargnée.
– Ça n’avait rien de divin. Une révélation, oui, c’était pourtant de l’ordre de la révélation. Mais d’une autre nature.
– La prise de conscience aiguë de ta condition de femme au foyer ?
– C’est ça fous-toi de moi. Non, quelque chose qui avait à voir avec le temps.
– Le temps qu’il faisait ? Le temps qui s’écoule ?
– Non non.
– Le temps du matin ? Le temps que tu passes à ranger la cuisine ?
– Oui, plutôt un truc de cet ordre-là : le temps spécifique du matin.
– Et tu as reçu ce temps en pleine figure.
– C’est presque ça : ce temps s’était démultiplié à l’infini, je regardai par la fenêtre de la cuisine et c’était comme quand on regarde l’intérieur d’un kaléidoscope. Tu sais, une multitude informe de morceaux bleus, roses, jaunes, qui s’assemblent quand on les agite et deviennent vitraux d’église, rosaces de cathédrale, motifs psychédéliques…
Katia, avec son âme d’artiste, était championne pour trouver des images originales, souvent aussi colorées que des tableaux, qui saisissaient, en quelques touches à peine, de subtils ressentis. Son visage fin au teint pâle de normande s’animait alors de rougeurs contrastées, et ses yeux gris clairs saillaient, larmoyants d’excitation.
De son côté, Céline, aussi peu intuitive que possible, mais ultra rationnelle, essayait toujours d’interpréter de manière sensée les délires quasiment mystiques de son amie, qui ne l’en fascinaient pas moins pour autant.
– Ce tube de carton ? Ce jeu d’enfants ? Avec des petits miroirs où l’image se projette en mosaïques?
Céline revenait du côté de la physique et des lois de l’optique.
– Oui, là, ce qui était éclaté, c’était la scène de rangement du petit déjeuner : chaque parcelle de temps, chaque geste était démultiplié, comme dans ces salles couvertes de miroirs où ton visage se reproduit à l’infini.
Céline eut une moue de dégoût.
– Très désagréable. Personnellement je déteste me voir répétée à des dizaines d’exemplaires dans une pièce. C’est étouffant, ces moi partout. Un seul moi, ça suffit.
– Et bien là, j’ai vu le temps de cette scène se rejouer des milliers de fois, il n’y avait plus ni présent, ni passé, ni futur, il n’y avait plus que cette scène, que moi à ranger les couverts sortis du lave-vaisselle, encore et encore, maintenant et pour l’éternité.
– Flippant ! La ménagère ad vitam æternam ! Condamnée pour toujours à trier la vaisselle ! Je comprends que ce rôle t’angoisse. Et c’est peut-être cette angoisse, cette sorte de cauchemar à répétition qui a provoqué ce flash.
– Non, ce n’est pas l’impression que j’ai eue. C’était, comment dire, une sensation plus profonde.
– Ah, je te vois venir, tu es capable de rajouter une dimension existentielle à la vulgaire banalité du quotidien.
– Tu sais comme je suis.
– Oui, je le sais, et aujourd’hui je vais avoir droit aux variations spirituelles sur toile de fond domestique.
– C’était vraiment plus fort, fascinant même.
– Et bien alors vas-y. Raconte-là moi, ton expérience.
Céline savait bien que Katia en mourait d’envie. Elle s’attendait à tout, au meilleur comme au pire. Elle s’installa confortablement dans la chaise de cuisine, attrapa son mug à deux mains et l’enserra de manière à ralentir le refroidissement du Pur Breakfast tout en se réchauffant les mains. Quelques mèches brunes pendaient et chatouillaient ses poignets, frôlant dangereusement la boisson brûlante. Elle but deux gorgées et ouvrit grands ses yeux sombres et ses jolies oreilles.
– Voilà. Ce matin encore, il y a moins d’une heure, j’étais debout là, exactement où tu me vois maintenant. Face à la fenêtre de la cuisine, avec cette vue sur le chemin. Gérard et les enfants venaient de sortir. La voiture s’éloignait. Un jour grisâtre et froid de plus se levait sur Bayeux. Un grand vide m’a envahie, comme chaque matin, après leur départ. Une angoisse indéfinissable m’opprimait.
Hou la la, ça sentait la dépression saisonnière à plein nez. Céline commençait à s’inquiéter pour l’équilibre émotionnel de Katia. Chômage et grisaille normande, un mélange dangereux pour la santé. Elle essaya de minimiser la chose.
– Ne cherche pas plus loin : tout simplement, ces quelques jours de mauvais temps t’ont tapé sur le système.
– Mais je ne me sens pas triste ! C’est plutôt une sorte de nostalgie qui m’accompagnait. Une nostalgie des jours vécus ici et de ceux encore à vivre, tous confondus, tous mélangés en une seule matinée, en un seul ensemble de gestes.
– Ah oui, ces gestes, ces fameux gestes, tu avais commencé par me parler de ça : les gestes du matin.
– Donc j’étais debout, ici même, face à cette fenêtre, une petite cuillère à la main…. oui, une petite cuillère à la main…
– Et ?
– C’est difficile à expliquer ! Un instant tellement court et pourtant tellement rempli, d’images, d’émotions, de souvenirs, comme un concentré de flash-backs et de … Il faudrait inventer un mot, le contraire de back en anglais, c’est quoi ?
– Face ? Front ? Je crois, mais tu sais, je suis nulle en anglais.
– Donc un concentré de flash-backs et de flash-faces… Je n’y arriverai jamais !
– Procède par description.
– Oui, tu as raison, reprenons au début… Donc j’étais debout, ici, face à cette fenêtre, une petite cuillère à la main… Arrrg !
– Vas-y, lentement, ne te décourage pas. Identifie les gestes. Ferme les yeux, remets-toi dans la situation.
L’esprit calme et cartésien de Céline aidait la nerveuse Katia qui tentait de se concentrer.
– Oui. J’essaie. Je m’y mets. Donc, je commence à vider le lave-vaisselle. Je pars du panier du haut. Je prends un verre. Je sens sur la pulpe de mes doigts le râpeux du produit vaisselle qui reste même après le rinçage et donne un toucher spécial, qui n’est ni celui du verre ni celui du produit de lavage. Je frotte machinalement mon doigt sur la paroi du verre pour bien identifier ce contact unique qui me repousse et m’attire en même temps. Je lève l’autre bras et ouvre la porte du placard mural, un peu trop en hauteur car fixé juste au-dessus de la fenêtre, cette fameuse fenêtre qui donne sur le chemin. Je maudis intérieurement l’architecte ou l’ouvrier qui a eu la bonne idée de poser un placard ici, et m’oblige à me mettre sur la pointe des pieds pour en ouvrir la porte. Elle grince très légèrement, c’est imperceptible, juste un couinement de reconnaissance entre elle et moi. J’allonge complètement le bras et entends un discret craquement dans le cou, signe d’élongation et d’alerte. Je maudis à nouveau les personnes précitées. À l’aveuglette, je repousse des doigts les autres verres déjà rangés dans le placard. Je me dis qu’il faudra vraiment un jour me décider à en acheter des vrais, autre chose que ces pots de moutarde et de Nutella recyclés, même si ce n’est pas un bon investissement car les gosses les cassent au rythme où on les mange, je veux dire que malgré notre consommation lente de moutarde et accélérée de Nutella, le stock de verres n’augmente pas, il reste globalement stable, il remplit l’étagère du placard et m’oblige tous les matins à les pousser vers le fond, encore grinçants et collants à cause des pastilles caustiques, pour y caser les autres, fraîchement sortis du lave-vaisselle. Je baisse le bras et le cou vers la gueule béante de la machine. Je me rends compte que les boîtes déjeuner de la veille y ont été mises fermées, remplies de restes de nourriture et qu’un Tupperware, à l’endroit et sans couvercle, déborde d’une eau blanchâtre qui me dégoûte. Je soupire après les gosses qui font ce qui les ennuie de travers. J’attrape du bout des doigts le Tupperware rempli d’eau froide, le vide dans l’évier avec la flemme de le laver à la main, je le remettrai ni vu ni connu dans le lave-vaisselle tout à l’heure. Je tire un petit coup sec pour lever le panier à couverts. Il résiste toujours et il faut donner une légère secousse pour le désenclencher du tiroir inférieur, accompagné du trinquaillement des couverts dérangés. Je sens contre ma paume la texture grise de la poignée, un gris légèrement granuleux. Je pose d’un geste souple et rond que j’aime bien, presque un geste sportif, le panier à couverts sur la planche à découper. Il lâche quelques gouttes d’eau dans la foulée et vient mouiller les miettes de pain collées sur la planche que j’ai négligé de laver. Je la lave toujours après, des fois que j’ai envie de me manger une dernière tartine grillée. J’ouvre le premier tiroir à couverts, qui glisse élégamment sur des roulettes. Je l’ouvrirais presque pour le plaisir. Je trie les couverts jaunes, qui vont dans ce premier tiroir, des couverts bleus, qui iront dans le second, en dessous, inaccessible lorsque le premier est sorti. J’applique ma technique affinée de séparation et attrape les couverts par genre : d’abord les plus longs, les couteaux, qui ne coupent guère, et que je peux saisir sans risque par la lame. Si c’est un couteau jaune, je le garde dans la paume de la main, si c’est un couteau bleu, je le pose à ma gauche, sur le plan de travail. J’assemble tous les couteaux jaunes dans le creux de ma main, alignés dans le même sens, la lame vers le haut. Avec le temps, j’ai appris à reconnaître les couteaux bleus, dont le manche coloré est pourtant caché par la partie basse du panier à vaisselle, au crénelé différent de leur lame, visuellement quand j’ai mes lunettes, ou au contact sinon. Je dépose alors l’ensemble des couteaux jaunes comme une gerbe dans le compartiment de droite du bac à couverts jaunes. Je pousse légèrement du tranchant de la main gauche les couteaux bleus en tas grossier sur le plan de travail. Je m’attaque aux fourchettes. Je saisis leurs dents, mais là, pas moyen de distinguer les jaunes des bleues, je fonctionne donc au petit bonheur la chance. Si c’est une jaune, elle est jetée dans son compartiment, si c’est une bleue, elle est mise de côté à gauche. Parfois, je garde deux-trois fourchettes jaunes dans la main avant de les ranger. Je continue par les cuillères. Les cuillères à soupe, c’est facile, il n’y en a qu’une sorte, à la couleur près, même principe, donc. Les cuillères à café, on en a cinquante sortes, que moi seule sais réellement ranger. Pour mon mari et mes enfants, cela reste des cuillères, qu’on jette dans les compartiments, où, vaguement, il y a des cuillères. Je commence par les couleurs. Les cuillères à café jaunes, elles sont banales et identiques, je les classe vite dans le tiroir ouvert. Les cuillères bleues, je les mets à gauche, en tas. Je ferme le tiroir du haut et ouvre le deuxième tiroir, tout aussi glissant et souple que le premier. C’est celui des couverts bleus et du reste. Tout est dans la poésie du reste. Je saisis les tas pré-triés et dépose à leur place couteaux bleus, fourchettes bleues, cuillères à soupe bleues. C’est là que ça se complique. J’attrape la masse des cuillères restantes et observe chacune d’entre elles. Si elle est plutôt grande et bombée, je la mets ici. Si c’est de la récup Air France – à l’époque, avant les attentats, ils faisaient encore de chouettes couverts en métal qui étaient juste à l’échelle de la bouche des gosses -, je la mets là. Si elle est minuscule, légère, parfois décorée, parfois sobre, mais toujours minuscule, c’est ma récup des cafés et des bars. Il y a quelques années, j’avais pris l’habitude de piquer une petite cuillère, mais pas plus d’une, dans chaque bistrot que j’aimais et où je sirotais mon allongé. Je la glissais subrepticement dans ma poche ou dans mon sac à main après l’avoir essuyée puis entourée d’une serviette en papier. Ainsi, à chaque petite cuillère était attribué un café particulier. Après bien sûr j’ai oublié, pour la plupart d’entre elles, quelle cuillère va avec quel café, mais le matin, quand je les saisis pour les ranger, j’adresse à mes préférées un sourire particulier, comme un clin d’œil entre amoureux, comme pour leur dire : tu te souviens de ce café que nous avons partagé à Deauville, près des fameuses Planches, tu te rappelles à Trouville-sur-Mer, en terrasse au soleil, sur le port, comme c’était bon, et hop, je les range avec des gestes doux dans le compartiment spécial, celui des minuscules cuillères à café, à droite des couteaux bleus, en haut des trois éplucheurs à légumes. Je sais, ce n’est pas terrible comme endroit, mais c’est le seul des compartiments à couverts qui se trouve être adapté à leur format microscopique. Et je suis là, debout face à la fenêtre et à sa vue triste, la ruelle déserte devant moi, un peu plus loin, les brumes de Bayeux, sur le côté, le bocage normand, ses arbres aux branches nues tendues comme des griffes vers un ciel uniformément gris, ma cuillère à café dans la main, et le temps s’abolit, se concentre, se démultiplie, éclate en paillettes kaléïdoscopiques. Chaque geste devient mille gestes, chaque lundi matin devient tous les lundis matins de ma vie. Je plonge dans l’infiniment petit. C’est une plongée sans fond car chaque acte peut être décortiqué encore plus finement, chaque mouvement se découpe en fractions d’action, chaque impulsion se fragmente en fractales de gestes. Je ne sais pas où est ma conscience. Dans la main qui tient la cuillère à café fauchée au café du théâtre à Cherbourg, dans le regard qui traverse la vitre de la fenêtre, dans la respiration suspendue lors de cette plongée, dans la clarté évidente de mon cerveau à ce moment ? Ou bien ma conscience est-elle dans la manière absolue dont m’appartient cet instant-là, qui se dilate en un univers complet et autonome, me procurant le sentiment, cuillère à la main, de vivre éternellement cette seconde ?
Katia arrêta là son monologue et put reprendre son souffle, ainsi que Céline qui n’en avait pas perdu une miette.
– Impressionnant. Tu crois que c’est la petite cuillère qui déclenche cet effet ?
– Je ne sais pas. La petite cuillère, ou la répétition tous les matins de gestes quasiment identiques, qui me plongent dans une sorte de transe.
– Tu as donc eu accès via un vidage de lave-vaisselle à l’éternité.
– Oui, on peut le dire comme ça. Certains côtoient l’éternité par l’intermédiaire d’une prière, d’autres pendant qu’ils font l’amour, d’autres encore face à un coucher de soleil sur l’océan… Moi, on pourra dire que ç’aura été à la cuisine en triant mes couverts jaunes et bleus, et en tenant une toute petite cuillère fauchée dans un café du Cotentin…
– État de grâce normand ! Tu vas concurrencer sainte-Thérèse !
– Ha ha, qui sait ? Tu reprendras bien un peu de thé ? Depuis le temps, il a dû refroidir.
– Avec plaisir ! La métaphysique ne nourrit pas son homme, et n’abreuve pas sa femme !
Les deux amies, aussi différentes que le jour et la nuit, rirent de concert.
La grisaille normande s’éloignait. Le jour se levait sur Bayeux. Aujourd’hui, il ferait peut-être beau. On pourra sortir, boire un café en terrasse, accompagné bien sûr, de sa petite cuillère.
© Isabelle Lebastard
2007
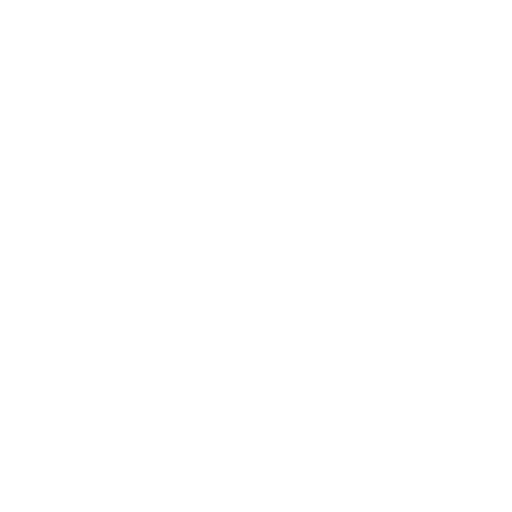 Prev
Prev